Pour revivre l’aventure des Sulpiciens
durant trois siècles et demi
Les Sulpiciens de Montréal, une des trois provinces de la Compagnie de Saint-Sulpice dont la maison mère est en France, fêtent, en 2007, leur 350e anniversaire d’arrivée. Conscients de l’importance de leur contribution au développement de Montréal et de la richesse du patrimoine qu’ils ont accumulé et préservé, ils ont voulu célébrer leur arrivée en 1657 de deux manières : par des activités spéciales qui se dérouleront tout au long de l’année de même que par une publication de prestige commandée à trois historiens.
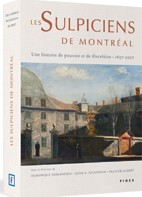
Crédit photo :Les Éditions Fides |
L’ouvrage, intitulé Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007, est paru aux Éditions Fides en février 2007. Elle comprend 670 pages réparties en vingt-et-un chapitres, préparés sous la direction de Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert avec la collaboration d’historiens bien au fait de l’histoire de la communauté et de la société montréalaise au sein de laquelle elle a œuvré. Une iconographie abondante, choisie judicieusement sous les soins de Jacques Des Rochers, accompagne le récit dont plus de la moitié des chapitres (11) apparaissent sous la plume des trois directeurs.
L’ouvrage fait revivre l’aventure en sol québécois des membres de la Province canadienne de la Compagnie de Saint-Sulpice. Tous les aspects de l’histoire de la Compagnie sont abordés, des volets plus spécifiques de ses activités faisant suite à la présentation de vues d’ensemble.
La communauté, ses membres, les grands moments de son aventure
L’ouvrage fait d’abord revivre les grands moments qui ont marqué l’histoire de la Compagnie et qui, à l’occasion, ont constitué des tournants dans ses activités missionnaires, pastorales et éducatives. Il présente la communauté en regard de la mission tracée par son fondateur, Jean-Jacques Olier, de sa structure et de la nature du lien — associatif — qui soude les membres entre eux dans leur résidence plus que tricentenaire, le Séminaire de Saint-Sulpice du 116, rue Notre-Dame Ouest. La publication renferme aussi une biographie collective de la communauté permettant de valider les grandes conclusions — secteurs dans lesquels les Sulpiciens ont concentré leurs activités à travers le temps — qui se dégagent au terme des études réalisées par les auteurs. Cette biographie prend appui sur une base de données prosopographique rejoignant les 650 associés de la Province canadienne depuis 1657 jusqu’à aujourd’hui; en regard de chacun, la base donne le nom et le prénom, l’année et le diocèse de naissance, l’année d’ordination et de sortie de naissance. Par la suite, des chapitres prennent la relève pour présenter le résultat d’analyses plus en profondeur de certaines activités des Sulpiciens qui ont mobilisé leur énergie et qui ont constitué la raison d’être de leur présence en sol québécois.
Les Sulpiciens comme seigneurs et propriétaires
Comme c’est la coutume au 17e siècle de soulager le trésor royal des dépenses reliées au support des colonies, les principaux acteurs qui y oeuvrent sont dotés. De façon à ce qu’ils puissent subvenir à leur subsistance et fournir à la collectivité québécoise des services de base, tels des places fortifiées de refuge et de défense et des moulins pour moudre le grain, les Sulpiciens reçoivent, en 1663, les seigneuries de l’île de Montréal et de Saint-Sulpice — la Société de Notre-Dame se démet en leur faveur —, et, en 1717, celle du Lac des Deux-Montagnes, concession royale suivie d’une augmentation en 1733. Le Séminaire de Saint-Sulpice sert alors de résidence aux membres de la communauté et de manoir seigneurial, où sont acheminés les revenus provenant des droits payés par les censitaires et des domaines que le Séminaire possède pour son propre usage.
La vie suit ainsi son cours jusqu’en 1840. Une loi passée en cette année abolit le système de tenure auquel est assujettie la Compagnie de Saint-Sulpice — l’abolition générale du système seigneurial pour l’ensemble du Québec aura lieu 14 ans plus tard, en 1854 —. La maison de Montréal acquiert la personnalité juridique requise pour ne plus avoir à se référer à la maison mère française. Désormais, elle possède en toute propriété les biens qu’elle s’est réservés en propre pour se ravitailler, qu’elle a défrichés, aménagés et sur lesquels elle a construit, dans le Vieux-Montréal, au domaine de la Montagne et à celui du Sault-au-Récollet. Les biens immobiliers de la Compagnie s’avéreront, tout au long de ces trois siècles et demi, des sources de revenus indispensables pour supporter les nombreuses initiatives qu’elle prend, pour pallier des conjonctures adverses et, en définitive, pour échapper à la faillite en raison de placements à perte faits par un de ses employés au début du 20e siècle.
Les Sulpiciens comme missionnaires
L’évangélisation des autochtones fait partie de la mission confiée aux Sulpiciens par leur fondateur parisien, Jean-Jacques Olier. Pour la réaliser, ils adoptent l’approche de la francisation, la vie en réserve. L’énergie déployée par les Sulpiciens pour la relocaliser, du domaine de la Montagne au Sault-au-Récollet, puis, de nouveau en 1721, au Lac des Deux-Montagnes, ne suffit pas à leur assurer le succès. Au 19e siècle, les Iroquois de la mission d’Oka revendiquent un droit de coupe de bois — pour la vente et non pour leur seul usage personnel — sur le domaine de la communauté de même que la propriété de leurs terres. Les Sulpiciens tentent de multiplier au milieu d’eux les établissements français et canadiens. Les Trappistes répondent positivement en achetant, en 1881, 1000 acres de terre pour y établir un institut agricole et une ferme modèle dont la réputation du fromage n’est plus à faire. Par contre, ils ne peuvent régler définitivement la question des revendications des Iroquois, même en achetant un canton ontarien, Gibson, et en supportant le départ et l’établissement sur celui-ci des mécontents — plusieurs familles ont apostasié —. Dans les années 1930, voyant qu’ils n’ont plus leur raison d’être dans une mission qui a abandonné en grand nombre le catholicisme, les Sulpiciens accélèrent la vente des propriétés qu’ils possèdent, non sans laisser dans la paroisse un héritage d’inspiration française. Le presbytère d’Oka (Deux-Montagnes) du 181, rue des Anges, rebâti après l’incendie de 1923, est aujourd’hui déclaré site du patrimoine par la municipalité. Dorénavant, les Sulpiciens se tournent du côté du Japon et de l’Amérique latine pour exercer leur apostolat missionnaire; là, ils connaissent le succès.
Les Sulpiciens comme curés de paroisse
S’il est une fonction dans l’exercice de laquelle les Sulpiciens se démarquent, c’est celle de pasteurs de la grande paroisse de Notre-Dame, à l’image de la grande paroisse de Notre-Dame de Paris. Pour la desservir, ils procèdent à la construction de ce qui est aujourd’hui deux basiliques, empruntant toutes deux à l’architecture française. La première, l’église Notre-Dame, par sa localisation en plein centre-ville et par ses dimensions imposantes, marque avec force le fait catholique et français. Elle explique la localisation de la cathédrale, dénommée aujourd’hui basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur, en périphérie de la vieille ville, d’abord à l’angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, par la suite à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue de la Cathédrale. La deuxième basilique, l’église Saint-Patrick, au service de la communauté irlandaise de langue anglaise, affirme haut la présence catholique dans cette partie de la ville occupée par les protestants. Les Sulpiciens laissent également en héritage des chapelles facilitant la desserte du grand territoire qui est le leur, la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours du 400, rue Saint-Paul Est, incendiée et relevée en 1771, de même que témoignant de l’importance accordée au culte à Marie, la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, du 430, rue Sainte-Catherine Est, inaugurée en 1876, œuvre de grande qualité architecturale et artistique — la toponymie de Montréal porte abondamment la marque de la dévotion de la communauté à Marie —.
Tout à côté de l’église paroissiale, monumentale, le Séminaire de Saint-Sulpice — qu’il ne faut pas confondre avec le petit séminaire ou Collège de Montréal —, résidence plus que tricentenaire des Sulpiciens, domine la vieille ville. Il témoigne à la fois de leur mission de pasteur, de leur conformité à l’une de leur règle, la vie en communauté, et de leur fidélité au modèle français : la grande paroisse, desservie à partir d’un point unique n’obligeant pas les pasteurs à s’isoler des membres de la communauté pour accomplir leurs charges. Avec la croissance de la population, les Sulpiciens doivent se résigner à la subdivision de leur paroisse par l’évêque de Montréal. Désireux d’en arriver à des unités plus près d’une population qui s’étend continuellement dans l’espace, Mgr Ignace Bourget entreprend, à compter de 1865, la création de nouvelles paroisses à même le territoire de la paroisse initiale de Notre-Dame. Progressivement, compte tenu de leurs effectifs, les Sulpiciens doivent se retirer de certaines cures. Ils orientent alors leurs effectifs, affectés aux charges presbytérales, vers un meilleur encadrement des ouailles, par la prédication et par une présence soutenue dans les confréries de dévotion qui se multiplient, telles par exemple les confréries de la Sainte-Famille, du Scapulaire, du Rosaire.
Les Sulpiciens comme éducateurs et formateurs
Si les Sulpiciens sont des pasteurs et des missionnaires, ils sont d’abord et avant tout des éducateurs, des formateurs de la jeunesse et du clergé diocésain.
Une jeune colonie comme la Nouvelle-France ne nécessite pas à ses débuts des institutions d’enseignement poussé. Les Sulpiciens investissent d’abord le secteur de l’enseignement élémentaire. Ils financent et dirigent de petites écoles, mais ne s’impliquent pas dans la tâche d’enseignement proprement dite. Ils en confient la responsabilité de préférence aux membres de communautés religieuses ou, à défaut, à des étudiants en théologie ou à des instituteurs et des institutrices laïques. L’engagement des Sulpiciens dans la formation élémentaire va décroissant à la fin du 19e siècle. À compter de 1906, il n’y a plus de Sulpicien agissant comme commissaire d’école; les dernières écoles à être financées par la communauté sont l’école Saint-Jacques, jusqu’en 1920, et l’école Saint-Laurent, jusqu’en 1930. Le secteur public a bien en main la relève et il épaule le privé.
La fin du 18e siècle et le tournant du 19e siècle amènent le besoin d’une formation plus poussée. Les Sulpiciens reconnaissent le bien-fondé des disciplines profanes. Ils financent le Collège Saint-Raphaël (1774-1803), par la suite le petit séminaire du faubourg des Récollets (à compter de1806) qui emménage au domaine de la Montagne en 1862 — aux côtés du Grand Séminaire déjà présent depuis 1857 —, pour devenir le célèbre Collège de Montréal du 1931, rue Sherbrooke Ouest.
Déjà, en 1840, le contexte n’est plus le même. Mgr Bourget confie, cette année-là, la formation du clergé diocésain aux Sulpiciens. Ceux-ci aménagent d’abord le Grand Séminaire de Montréal dans des locaux du petit séminaire — qui devient le Collège de Montréal — et entreprennent la construction d’un bâtiment au domaine de la Montagne, au 2065, rue Sherbrooke Ouest, qui ouvre ses portes en 1857. Avec le temps, ils mettent davantage l’accent sur la formation sacerdotale. Le Collège de Montréal perd les deux dernières années du cours classique, les plus prestigieuses comme certains disent à l’époque, au profit du Séminaire de philosophie, une institution préparatoire au Grand Séminaire, qui ouvre ses portes en 1876, au domaine de la Montagne, plus précisément au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges. De 1911 à 1927, une école ayant comme principale mission de préparer au Séminaire de philosophie, est aussi en opération au domaine de la Montagne, l’École Saint-Jean-l’Évangéliste.
Le 20e siècle marque le retour du balancier. Les Sulpiciens se tournent davantage vers les étudiants qui se destinent à des professions autres que la carrière sacerdotale. En 1927, ils créent le premier externat classique, le Collège André-Grasset, dans la partie sud-est de leur domaine du Sault-au-Récollet, au 1001, boulevard Crémazie Est. En 1951, ils implantent un autre externat classique à Verdun, en milieu populaire, le Collège Jean-Jacques-Olier, institution constituant une sorte d’annexe du Collège de Montréal. Du côté de l’enseignement universitaire, les Sulpiciens ne sont pas en reste. Ils contribuent par leurs ressources financières et leurs membres au développement de l’Université de Montréal — Mgr Olivier Maurault sera recteur de l’Université de Montréal —.
La révolution tranquille et ses conséquences, la sécularisation de l’enseignement, l’intervention du secteur public et la désaffection des étudiants pour la carrière sacerdotale, amènent les Sulpiciens à réorienter leur action. Ils se retirent du Collège Jean-Jacques-Olier de Verdun en 1965. Dans les années 1990, ils confient les collèges de Montréal et André-Grasset à des corporations privées autonomes. Le Séminaire de philosophie est aujourd’hui rattaché au Collège Marianopolis. Par là, les Sulpiciens peuvent mieux recentrer leur action au Grand Séminaire, sur la mission première qui leur avait été confiée par leur fondateur, la formation du clergé — la communauté des Sulpiciens n’accepte que des prêtres déjà ordonnés qui doivent franchir l’étape de la « solitude » avant de devenir pleinement associés — dont une partie importante des aspirants provient de leur mission au Japon et en Amérique latine.
Les Sulpiciens sont-ils des « travailleurs sociaux »?
Les Sulpiciens ne sont pas une communauté ayant l’assistance sociale comme objectif prioritaire. Nulle surprise que le mémoire présenté à la Commission de la culture, en 2005, ne mentionne aucune propriété, affectée aux œuvres caritatives, comme ayant une très grande valeur en matière de patrimoine culturel.
Les Sulpiciens n’en jouent pas moins un rôle important à Montréal dans le secours aux plus démunis, en particulier dans la seconde moitié du 19e siècle. Ils interviennent comme corps de différentes manières : par des aumônes destinées au remboursement des fournisseurs de nourriture et de bois de chauffage aux pauvres; par des souscriptions et un support — cession de terrain, location de maisons à des taux avantageux, prise en charge de la clientèle hébergée — aux institutions d’assistance. Face à celles-ci, ils réservent leurs ressources plus particulièrement aux Sœurs grises de l’Hôpital général. Ils s’impliquent également pour faciliter l’implantation de communautés, dont les Frères de Saint-Gabriel, une communauté qui se consacre à la formation des orphelins. Les Sulpiciens interviennent aussi dans la prolongation de leur charge de pasteur paroissial et comme individu, pour mettre leur fortune personnelle au soulagement de la misère.
Les Sulpiciens comme animateurs culturels
Les Sulpiciens jouent un rôle majeur auprès du grand public montréalais pour développer le goût pour les arts d’inspiration française : musique, chant, beaux-arts et architecture. Leur contribution s’effectue par l’importation d’œuvres artistiques, par des commandes à des artistes français de même que par une incitation d’artistes québécois à leur service à poursuivre leur formation auprès de maîtres français.
Les Sulpiciens sont aussi hommes de lettres, sachant intéresser les Montréalais à leur histoire et, d’une façon plus générale, à la bonne lecture. Chargé de la visite des maisons sulpiciennes en Amérique pour le compte du Supérieur général, Étienne-Michel Faillon laisse en héritage une production historique étonnante : des biographies des religieuses fondatrices d’institutions montréalaises, une histoire générale de la Nouvelle-France jusqu’en 1675, en trois volumes, plusieurs recueils de documents permettant de compléter son œuvre. Par ses écrits, Olivier Maurault, directeur du Collège André-Grasset et aussi recteur de l’Université de Montréal, redonne aussi vie au souvenir de sa communauté.
Enfin, les Sulpiciens contribuent à propager le goût de la lecture parmi le grand public et à l’orienter. Sur ce point, ils se démarquent tout particulièrement en mettant sur pied la première grande bibliothèque francophone. Leur contribution financière, leurs bibliothèques personnelles, des dons de particuliers donnent naissance à une collection qui passe du Cabinet de lecture paroissial, localisé en face du Séminaire de Saint-Sulpice en 1857, à la Bibliothèque Saint-Sulpice du 1700, rue Saint-Denis, qui ouvre ses portes en 1915 — acquise en 2005 par l’Université du Québec à Montréal —. À la suite des difficultés financières rencontrées par les Sulpiciens, l’édifice et ses collections sont achetés par le gouvernement du Québec en 1941. Les bases sont désormais jetées pour la création de la Bibliothèque nationale du Québec, aujourd’hui Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
La mémoire des Sulpiciens
La présente publication est tout à l’honneur des directeurs et de ceux qui y ont collaboré. Elle contribue à redonner vie au patrimoine immobilier de Montréal. Une lecture attentive permettra sûrement au visiteur qui déambule le dimanche après-midi de redécouvrir une face cachée de certains bâtiments devant lesquels il a coutume de passer. Pour les activités moins visibles de la communauté, comme la prédication ou sa présence auprès des congrégations religieuses, les archives que les Sulpiciens préservent soigneusement, en conservent la trace et ne demandent qu’à être consultés. Abondamment citées par les auteurs de l’ouvrage, elles créent un nouvel intérêt pour les archives paroissiales dans leur ensemble, dont il existe maintenant au Québec des inventaires pour certains diocèses.
Gilles Durand
