Bulletin n°25, mai 2008
Un numéro tout à fait spécial de la Revue française de généalogie à garder à portée de la main
Un numéro tout à fait spécial de la Revue française de généalogie
à garder à portée de la main
par Gilles Durand
À l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain, La Revue française de généalogie vient de lancer un numéro spécial Nos cousins d’Amérique. Le rédacteur en chef, Charles Hervis, et le coordonnateur de ce numéro, Pierre-Gabriel Gonzalez, tentent par cette livraison de répondre aux besoins de tous leurs compatriotes français qui comptent des ancêtres partis pour l’Amérique et qui s’interrogent sur le « comment retracer leurs cousins ». La tâche à accomplir était lourde : 400 ans d’histoire, des communautés dispersées sur tout le continent nord-américain, des liens conservés en permanence de part et d’autre de l’Atlantique que l’histoire n’a jamais pu briser, des peuplades autochtones ayant leurs propres racines, une documentation diversifiée et abondante. Pour relever le défi, la revue a eu recours à des collaborateurs bien engagés dans leur milieu : historiens spécialistes, généalogistes experts, conservateurs de musée et archivistes chevronnés.
Nulle surprise que la revue mette d’abord en contexte les lignées bâties – et à bâtir — par les généalogistes, à partir des relectures les plus récentes du passé : les grandes figures reliées aux premières découvertes et aux explorations — sujets souvent abordés, mais loin d’être épuisés –, l’administration et la défense de la colonie, les activités économiques, la vie de tous les jours dans la vallée du Saint-Laurent — alimentation, logement, vêtement, déplacement, etc. –, la formation et la dispersion des communautés sur le continent nord-américain. Une des grandes qualités des articles publiés sur ces sujets, c’est d’aller à l’essentiel tout en suscitant l’intérêt du lecteur pour épuiser lui-même la matière, par exemple par la visite d’un musée, par la lecture du plus récent ouvrage sur le sujet ou encore en naviguant sur Internet vers des sites d’un grand intérêt. Autant d’occasions pour les généalogistes de découvrir peut-être un côté caché de l’histoire de leur famille qu’ils ignorent.
Rares sont les chercheurs qui, une fois leur lignée retracée, ne sentent pas le besoin de les bonifier par la mise à jour de leurs connaissances sur les découvertes les plus récentes dans le monde de la généalogie. Ceux-ci trouveront amplement matière à se ressourcer dans le présent numéro – et c’est là une autre de ses grandes qualités. Des experts et habitués de la généalogie font le point sur les sites Web, les grandes bases de données et les outils de recherche accessibles sur Internet. Tout ne peut être numérisé bien évidemment. Pour l’information originale qui ne l’est pas encore, la revue prend soin de pointer les centres d’archives et les musées susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives. Quant aux chercheurs qui auraient encore besoin d’aide, ils trouveront dans ce numéro les coordonnées d’associations capables d’encadrer leurs travaux et de favoriser le partage des connaissances avec des personnes engagées dans des recherches similaires.
Le numéro spécial de La Revue française de généalogie, auquel des membres et proches collaborateurs de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs ont apporté leur contribution, constitue un outil de recherche à conserver à portée de la main, pour qui veut avoir facilement accessible l’information la plus récente sur les cousins d’Amérique et sur leur vécu. C’est une publication d’une grande utilité tant pour les généalogistes français que québécois. Rendez-vous à l’adresse www.rfgenealogie.com pour découvrir le site Internet de la revue.
L’historien Denis Vaugeois reçoit le prestigieux prix Gérard-Parizeau 2008
L’historien Denis Vaugeois reçoit le prestigieux
prix Gérard-Parizeau 2008
par Gilles Durand
Pour faire écho au 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, le Prix Gérard-Parizeau 2008 vient d’être remis à Denis Vaugeois.
Cet insigne honneur revient à cet historien engagé pour son apport à faire mieux connaître le rôle du Québec comme principal pôle de développement du fait français en Amérique du Nord. Comme chercheur, écrivain et éditeur, le récipiendaire contribue d’une façon soutenue à créer un intérêt marqué auprès du grand public pour l’histoire du rayonnement de la société et de la culture françaises. Parmi les nombreux ouvrages qu’il a fait paraître seul ou en collaboration, entre autres aux Éditions Septentrion, mentionnons :
- Canada-Québec : synthèse historique, 1534-2000, en collaboration avec Jacques Lacoursière et Jean Provencher, réédité en 2000;
- America, 1803-1853 : l’expédition de Lewis & Clark et la naissance d’une nouvelle puissance, 2002;
- Champlain : la naissance de l’Amérique française, en collaboration avec Raymonde Litalien, 2004;
- La mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814, en collaboration avec Raymonde Litalien et Jean-François Palomino, publié en coll. avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et les Presses de l’Université Paris – Sorbonne, 2007.
Tout au long de sa carrière, Denis Vaugeois s’est aussi démarqué comme professeur, cadre au sein de la fonction publique, député et ministre dans le gouvernement du Parti québécois.
Le Prix Gérard-Parizeau est un des prix les plus généreux en sciences humaines au Québec, soit une bourse de 30 000 $. C’est une récompense que mérite le récipiendaire.
Pour des informations additionnelles, consulter http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/auteurs.asp?DevID=196
Pour une photo de la remise du prix, consultez l‘hebdomadaire d’information Forum de l’Université de Montréal à l’adresse
Traverser l’Atlantique avec Champlain
Traverser l’Atlantique avec Champlain
par François Bellec
de l’Académie de marine
Lorsque l’Europe du Nord eut assimilé la science de la haute mer élaborée par les Portugais, les nations en réserve du Nouveau Monde prirent leur tour sur les routes des Indes orientales et occidentales. La crise religieuse qui levait sur la chrétienté un tourbillon de haines et de persécutions, et, d’autre part, la naissance d’une nouvelle économie de fourmilière firent la fortune d’Anvers puis d’Amsterdam. Alors, dominé par de puissantes compagnies de négoce conciliant les intérêts des investisseurs et des États, le 17e siècle fut le temps des marchands au long cours. La prééminence économique et les initiatives expansionnistes basculèrent définitivement des royaumes catholiques conservateurs du Sud, notre sphère culturelle originelle, aux nations protestantes libérales du Nord, aux Pays-Bas puis à l’Angleterre, et cette montée en puissance annonçait à terme que la France perdrait un jour le Canada.
L’état des lieux
La navigation hauturière occidentale est née en Atlantique dans les années 1460, quelque six siècles après son invention dans l’océan Indien et une trentaine d’années après que les Portugais aient rompu la barrière culturelle de la « mer des Ténèbres » en franchissant le cap Bojador en 1434. Obligés de tirer des bords contre les alizés du nord-est et l’harmattan lorsqu’ils rentraient du golfe de Guinée vers Lagos, ils avaient imaginé la première option météorologique: la volte vers les vents d’ouest soufflant à la latitude des Açores. Pour la première fois en Europe était apparu le risque de se perdre en haute mer, et donc, le besoin de faire le point.
La carte portulan et le compas magnétique, présents en Méditerranée depuis le 13e siècle, mais inutiles dans une petite mer fermée, étaient devenus nécessaires et vite insuffisants. La constatation que l’étoile Polaire qui indiquait déjà le nord matérialisait aussi le chemin parcouru vers le nord ou le sud avait fondé la navigation en latitude. Parce que l’étoile guide parcourait chaque jour un cercle de rotation d’un diamètre de 6 ° à l’époque – 2 ° maintenant -, il fallait moduler son observation. Le Regimento da Estrela do Norte, le « règlement de l’étoile Polaire » avait été la première table astronomique à l’intention des navigateurs, fondée sur la rotation des « gardes », des étoiles caractéristiques de la Grande ou de la Petite Ourse. Le quadrant de hauteur avait été le premier instrument de mesure à la disposition des navigateurs. Il était déjà utilisé par les Arabes et les Persans dans l’océan Indien pour le même usage. On avait commencé dès lors à naviguer « en latitude » en Atlantique.
Quand les Portugais avaient atteint l’équateur en 1471, plus d’un demi siècle après le début de leur entreprise d’ouvrir une route directe vers les Indes, la disparition de l’étoile Polaire avait obligé à imaginer une autre référence astronomique. Dans les dernières décennies du 15e siècle, les caravelles de découvertes avaient embarqué des astrolabes nautiques et les premières tables de déclinaison, les Regimentos do Sol. Spécifiquement conçu pour observer la culmination du soleil sans se brûler les yeux, l’instrument robuste et rustique n’avait aucun rapport avec l’astrolabe planisphérique, un instrument savant inutilisable à la mer. Il lui empruntait seulement son alidade, nécessaire au calage préliminaire de sa projection de la sphère céleste locale. C’est-à-dire la façon dont on voit le ciel étoilé en un lieu donné. La latitude par le soleil méridien fut le premier procédé universel de navigation astronomique de l’histoire de la navigation. Elle contribua à donner aux Européens une capacité d’expansion maritime mondiale sur des mers inconnues. L’arbalète ou arbalestrille, dérivée du bâton de Jacob des vieux arpenteurs, était apparue en mer en 1515. Elle transférait la référence pendulaire de l’astrolabe à une référence à l’horizon. L’arbalète fut sous le nom de Graadbog l’instrument préféré des Hollandais jusqu’au 18e siècle. Un nouvel instrument, le quartier de Davis ou Back-staff avait été décrit en 1595.

Loch à plateau et sablier associé. Musée de la Marine, Paris.Source : Wikipedia, l’encyclopédie libre |
Au temps de Champlain, un Anglais anonyme avait inventé depuis quelques décennies le loch à ligne. Le premier ouvrage de navigation d’inspiration britannique originale A Regiment for the Sea de William Bourne, édité en 1574, décrivait pour la première fois le loch à plateau. Il consistait en un quadrant en bois grand comme une main, lesté le long d’un de ses côtés et amarré à un long filin par une patte d’oie favorisant sa flottaison en position verticale, pour s’opposer naturellement à l’entraînement quand on le jetait à la mer. La cordelette était graduée par des nœuds régulièrement espacés. Une facilité particulière était offerte par la proportionnalité de 1/120. En effet, si l’on stoppait la cordelette à la fin de l’écoulement d’une ampoulette de 30 secondes soit un cent vingtième d’heure, le nombre de nœuds filés pouvait donner directement la distance parcourue en une heure, si l’espacement des nœuds était égal au 1/120e de l’unité de distance. C’est pour cette raison pragmatique, qu’un navire file N nœuds, quand il parcourt N milles par heure. Resta à se disputer sur la longueur du mille et l’espacement des nœuds.
Le conservatisme des gens de mer
Suivant une constante de l’histoire de la navigation, les efforts faits en France et en Angleterre pour améliorer la navigation et sensibiliser les pilotes ne bousculèrent pas la navigation. Samuel Pepys exerça brillamment la charge de Secrétaire du Board of Admiralty de 1673 à 1679. Il releva la marine de Charles II et fonda en 1673 l’école de mathématiques de Christ’ s Hospital, car il estimait que la Navy avait d’abord besoin d’un enseignement poussé vers les mathématiques et la navigation, pour utiliser correctement les outils rendus disponibles depuis trois quarts de siècle. Dix ans plus tard, en 1683, en route pour Tanger avec l’escadre anglaise, Pepys demanda de faire établir l’estime par tous ceux qui étaient capables de la calculer. Les résultats dispersés en tous sens étaient tous erronés de plus de 25 lieues. Lors du voyage de retour, l’escadre reconnut le cap Lizard alors que l’on guettait la côte française. Pepys conclut d’abord que « la Providence, beaucoup de chance et l’immensité de la mer sont les uniques raisons pour lesquelles il n’y a pas plus de désastres et de mauvaises fortunes dans la navigation. » Il dénonça surtout les méfaits de la routine et du manque d’esprit critique des masters chargés de la navigation, parce qu’ils ne pensaient pas à recouper leurs observations, et ne tiraient pas parti des constations quotidiennes des erreurs évidentes et des inattentions coupables. « Mais dès que la terre est en vue, toute différence (entre l’estime et l’observation) est oubliée, ainsi que tout désir de tirer enseignement des faits. Au contraire, chacun fait tous ses efforts pour démontrer qu’il avait raison, sans penser qu’ils se retrouveraient tous dans le même embarras au même endroit. De là vient le fait que la science de la navigation est restée depuis si longtemps sans faire de progrès. »
La navigation au temps de Champlain
On oublie trop que Samuel Champlain était un marin confirmé. Pour donner une idée de la navigation en son temps, il suffit de l’écouter parler. On a prêté peu d’attention à l’époque à son Traité de la Marine et du devoir d’un bon mariner de la navigation annexé aux Voyages de la nouvelle France Occidentale dite Canada publiés en 1632. Et cette inattention perdure. Au point que lors de la réédition de ces voyages en 1951 par les PUF – un éditeur universitaire parmi les plus crédibles – sous le titre Les voyages de Samuel Champlain, on a coupé purement et simplement la partie technique de ce mémoire avec cette explication abrupte : « La suite du Traité est principalement consacrée à la confection des cartes et aux procédés pour faire le point. » Cela en dit long sur l’inattention héréditaire des Français aux choses de la navigation. Sur le plan historique, cette inattention est d’autant plus coupable que nos universitaires ont couvert de louanges imméritées la médiocre Hydrographie du Père Fournier publiée onze ans plus tard. Sans doute n’attendait-on pas Champlain sur ce chapitre et l’on a eu grand tort d’oublier sa formation maritime précoce et son sens aigu de l’observation. En tout cas, la lecture de son traité pragmatique rend insupportables la suffisance de salon et les âneries nautiques du Père Fournier.
Champlain ouvre ainsi son mémoire :
« Après avoir passé trente-huit ans de mon âge à faire plusieurs voyages sur mer & couru maints périls & hasards (desquels Dieu m’a préservé) & ayant toujours eu désir de voyager es lieux lointains & étrangers où je me suis grandement plu, principalement en ce qui dépendait de la navigation, apprenant tant par expérience que par instruction que j’ai reçue de plusieurs bons navigateurs, qu’au singulier plaisir que j’ai eu en la lecture des livres faits sur ce sujet, c’est ce qui a motivé, à la fin de mes découvertes de la nouvelle France Occidentale, pour mon contentement, de faire un petit traité intelligible & profitable à ceux qui s’en voudront servir. »
La première partie du Traité de la Marine prodigue au capitaine des recommandations sur l’ordre, la vigilance et le soin qu’il doit apporter en tout ce qui concerne la préparation et la tenue du navire, la conduite de son équipage et la sécurité du mouillage et de la navigation. Craindre Dieu tout d’abord, et le prier. Embarquer même un professionnel si possible : « Je lui conseille de mener avec lui un homme d’Eglise ou Religieux habile et capable. »
Les conseils en matière de navigation ont trait à la tenue de l’estime et à la façon de naviguer en latitude. La carte d’abord. Champlain insiste sur la nécessité d’avoir une carte exacte. « Il n’y a rien de si utile pour la navigation que la carte marine. » Elle était encore en projection « plate », c’est-à-dire qu’elle ne tenait pas compte de la convergence des méridiens aux pôles. Le canevas de Mercator, fondement de la cartographie moderne, était publié depuis 1569. La mappemonde Terrae Descriptio en projection de Mercator restait une curiosité. Le premier atlas nautique, le Neptune Français en projection « réduite », serait publié en 1693. Les marins sont conservateurs. Il fallait donc effectuer soi-même la réduction par le calcul ou par un artifice graphique. Champlain dit bien qu’il faut utiliser les cartes en « les réduisant du rond au plat, encore qu’il y ait quelque difficulté. » On utilisait pour cela des abaques ou Quartiers de réduction figurant dans tous les ouvrages nautiques. Quant aux cartes, le Spieghel der Zeevaerdt de Waghenaer avait été une révolution en 1584. La cartographie nautique hollandaise imprimée était traduite en français depuis 1590 (Le nouveau miroir des voiages marins). Le Spieghel ne couvrait pas l’Amérique et c’était un ouvrage décoratif coûteux, plus adapté aux bibliothèques des armateurs, des marchands et de la société éclairée, qu’aux tables à cartes des navires de commerce. Les cartes manuscrites héritées des portulans étaient, plus encore que les cartes imprimées, des documents rares et dispendieux. Plusieurs témoignages attestent l’absence de toute carte, document ou instrument, à l’exception des carnets traditionnels d’instructions de route et de sondes, à bord des caboteurs des mers nordiques dans la seconde moitié du 16e siècle. On pouvait très bien se construire soi-même un canevas pour traverser l’Atlantique et Champlain explique comment dresser une carte, sur la base de dix-sept lieues et demie par degré de latitude. C’était trop court mais c’était encore la donnée admise sur une Terre dont on appréciait mal les dimensions. On débattait beaucoup en Angleterre de la longueur du mille marin, mais il faudrait attendre le 18e siècle pour que l’on adopte en France vingt lieues comme étant la longueur convenable du mille.
Le compas de mer consistait depuis le 14e siècle en une rose des directions dite sèche, en papier, assujettie à une aiguille aimantée ou à un équipage de plusieurs aiguilles parallèles. On gouvernait encore par référence à 32 rhumbs de 11°15’, soit les 8 « vents entiers » tracés en noir (nord ou nord-est), les 8 « demi vents » (nord nord-est), et les 16 « quarts de vents » (nord-est quart nord). Posée librement sur la pointe de son pivot, la rose était équilibrée par de légers contrepoids en cire ou en plomb. L’ensemble était contenu dans une boîte en forme de cylindre ou de bol en bois tourné ou en métal non ferreux, généralement du laiton ou du cuivre, que l’on espérait exempt de particules de fer, ou d’une forme carrée en bois, qui s’était généralisée en France au milieu du 17e siècle. Les progrès techniques avaient porté sur les aiguilles, sur leur pivot, sur la matière et la forme de l’habitacle du compas. L’art du pilote était d’entretenir la force de l’aiguille en la « touchant » avec la pierre d’aimant. « Avoir une bonne pierre d’aimant, quoi qu’elle coûte. Oter tout le fer d’auprès les compas et boussoles car cela est grandement nuisible. » On avait remarqué sans la comprendre l’influence de masses ferreuses sur l’aiguille aimantée, mais les notions de déviation étaient encore très confuses. Quant à la déclinaison magnétique c’était une autre affaire. « N’oublier souvent à apprendre les déclinaisons en tous lieux de l’aguidément (Il aurait dû écrire la guide aimant, pour « l’aiguille aimantée»). La coexistence de la navigation magnétique et de la navigation astronomique entraînait une source de perplexité en raison des fortes anomalies magnétiques aux abords de Terre-Neuve. Il était difficile de corréler, dans l’Atlantique Nord, l’estime fausse déduite des compas fortement déviés, et d’autre part les observations astronomiques de latitude lors des atterrissages sur le Canada. En faisant route à travers l’Atlantique sans tenir compte de la variation de la déclinaison magnétique – ou sans s’en apercevoir – , l’estime des pilotes les mettait en un point plus bas en latitude qu’ils le croyaient puisque, en suivant un cap magnétique à l’ouest, ils faisaient en réalité une route vraie à deux quarts vers le sud-ouest aux abords de Terre-Neuve.
Restait encore à estimer la vitesse, pour calculer l’estime et « pointer» la carte comme on disait à l’époque. La pratique universelle très grossière consistait à mesurer le temps de défilement le long du bord d’un morceau de bois jeté par dessus bord à la proue, connaissant la longueur du navire. L’observateur récitait une formule scandée qu’il avait étalonnée à l’aide d’un sablier d’une minute ou de trente secondes. Le résultat était d’autant plus erroné que l’on allait vite. Soixante ans après sa description, Champlain est le premier navigateur français à avoir mentionné le loch à plateau, un instrument « qui m’a semblé fort sûr – disait-il – au respect des estimes que l’on fait ordinairement». Incertain sur sa vitesse, on faisait en sorte de la surestimer, de manière à éviter de tomber trop tôt à la côte. « On ne doit oublier une chose en l’estime, qui est de faire plus de l’avant que de l’arrière.»
Restait à vérifier sa latitude chaque jour à l’arbalète par l’étoile Polaire grâce aux tables de correction en regardant les gardes, ou grâce à l’astrolabe par le soleil méridien, avec l’aide d’une table éphéméride de la déclinaison solaire. L’arbalète tirait son nom de sa forme, et l’on manipulait l’astrolabe à bout de bras comme un peson. On semblait donc fusiller les étoiles et peser le soleil.
Au bout du compte, on ne manquait pas de sonder pour détecter la brusque remontée des fonds abyssaux à 200 mètres. Le plateau continental ou le Grand Banc de Terre-Neuve étaient des signes avant-coureurs de l’approche de l’Amérique. La sonde est aussi vieille que la navigation antique. Et puis on arrivait quelque part. L’art du navigateur était alors d’identifier le rivage. Et au besoin, il demandait sa route aux pêcheurs. A toutes ces approximations près, on naviguait intensément à travers l’Atlantique. A la grâce de Dieu.
Pour joindre l’Académie de marine :
contact@academiedemarine.fr
21, place Joffre
75007 PARIS (France)
01 44 42 47 97
Galilée, deux ou trois choses que je sais de lui
Galilée, deux ou trois choses que je sais de lui
par Françoise Balibar
Physicienne, auteure
Tout le monde connaît, ou croit connaître, Galilée. Reprenant au cinéaste Jean-Luc Godard le titre d’un de ses films, « Deux ou trois choses que je sais d’elle », je voudrais ici ajouter à ce que tout le monde sait « deux ou trois choses » moins connues que je sais de lui, Galilée.

Galileo Galilei par Domenico Robusti en 1605.Source : Wikipedia, l’encyclopédie libre |
Galilée était musicien. Son père Vincenzio Galilei (1520-1591) exerçait ce métier : à la fois, exécutant (excellent joueur de flûte), et théoricien de la musique (il écrivit plusieurs traités sur le sujet). En tant que musicien, Vincenzio faisait partie d’une « académie », formation sociale caractéristique de la Renaissance italienne, regroupant dans chaque ville d’importance les professionnels d’une même discipline, sans entretenir pour autant des rapports obligés avec l’université (c’est-à-dire avec ce que nous appelons aujourd’hui le monde « académique »). Son fils, Galileo Galilei (francisé en Galilée), sans être un professionnel, était lui-même bon musicien. Suffisamment en tout cas pour que le jour où, réalisant des expériences sur la chute des corps (pour lesquelles il est, entre autres, célèbre), il eut besoin de mesurer des temps de chute –c’est-à-dire compter le nombre d’intervalles de temps égaux que l’on peut loger dans le temps que le corps met à tomber –, il eut recours à un procédé auquel seul un musicien pouvait penser : chanter des airs en maintenant un tempo (rythme) déterminé. Il faut se souvenir qu’à l’époque, les horloges étaient très imprécises (en particulier parce que les dispositifs mécaniques de mesure du temps, écoulement d’un sablier ou battements périodiques, ne permettaient pas de reproduire des intervalles de temps rigoureusement égaux). Galilée était suffisamment sûr de son sens musical et de sa capacité à maintenir imperturbablement un tempo pour préférer ce moyen non mécanique (de fortune, dirions-nous aujourd’hui où l’idée de science sans instruments de mesure nous est étrangère) à tout autre dispositif plus
technique.
On se souviendra à cette occasion de cette maxime énoncée par Galilée, fondatrice de la nouvelle science : « mesurer tout ce qui peut être mesuré et rendre mesurable ce qui ne l’est pas ». Objectif inédit à l’époque où l’activité scientifique était identifiée à la recherche des causes (déterminer la cause produisant tel ou tel phénomène), ce pour quoi il n’est pas nécessaire de disposer d’une description quantitative du phénomène à « expliquer ». L’idée qu’une telle description ne soit pas suffisante est à l’époque une idée neuve ; qu’il faille la compléter par une description quantitative, une mesure, ouvre la voie à l’idée de mathématisation impliquant des rapports rigoureux entre des grandeurs bien déterminées.
Galilée avait étudié le dessin. Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de savoir que Galilée, outre ses dons de musicien, possédait aussi des compétences en dessin, acquises dans sa jeunesse. Compétences qui lui furent d’un grand secours lorsque pointant vers le ciel la lunette qu’il avait construite en perfectionnant un gadget acheté à des marchands ambulants hollandais sur le marché de Venise, il observa, pour la première fois, des montagnes sur la lune ; preuve que la lune, objet céleste par excellence, n’est pas d’une nature différente de la Terre ; en contradiction avec la thèse soutenue dans les universités, sous la domination de l’Eglise, selon laquelle la Terre est à la fois le centre du monde autour duquel tout tourne et le lieu de l’inégal, du transitoire, du changement, de la vie et de la mort, par opposition au ciel, figuré par une sphère lisse, sans creux ni bosses, éternelle et immuable, en rotation autour du centre de la Terre. Cela se passait durant l’été 1609 (pour fixer les idées, on se souviendra que 1608 est l’année où fut fondée la ville de Québec). Galilée possédait alors la seule lunette au monde permettant d’observer la surface de la lune. Il lui fallait donc, pour faire connaître aux autres savants sa découverte, décrire ce qu’il avait vu, avec des mots, et mieux encore, illustrer son propos par le dessin. Avoir appris les diverses techniques du dessin, et en particulier celle qui permet de rendre le relief au moyen de hachures diversement inclinées, lui fut alors d’un grand secours (Figure montrant la surface de la lune dessinée par Galilée – parue dans le “Sidereus Nuncius” (Messager céleste, ou des étoiles, selon les traductions) dont le crédit est Bibliothèque nationale, Florence, Italie et photographiée et ayant pour crédit « Mission Apollo 11 ; Nasa, Washington » — p. 34-35 de Jean-Pierre Maury, Galilée, le messager des étoiles, Paris, Gallimard, 1986).
Que Galilée n’ait pas hésité à mettre en œuvre ses capacités de dessinateur en dit plus qu’il n’y paraît sur ce qu’est la science moderne, celle qui précisément naît avec lui, celle dont la science actuelle est l’héritière. En effet, Galilée utilise le dessin comme un moyen, un outil destiné à emporter l’adhésion intellectuelle, la conviction de ses contemporains — à la fois ses adversaires (les tenants du mode de pensée traditionnel, accrochés à l’idée que la Terre est immobile au centre du monde et le ciel d’une nature différente), et les autres, ceux que l’on désigne du nom d’ « honnête homme » au 17ème siècle ; deux catégories d’interlocuteurs représentés dans le Dialogue sur les deux systèmes du monde (ouvrage qui vaudra à Galilée de graves ennuis avec l’Eglise, comme chacun sait), par les figures de Simplicio (que son nom suffit à caractériser) et Sagredo (l’honnête homme). Là aussi, s’exprime une idée neuve, celle selon laquelle l’activité scientifique, parce qu’elle vise à convaincre des interlocuteurs, ne peut pas se développer sans ces interlocuteurs, justement. Le savant moderne n’est pas — en tout cas, ne doit pas être, si l’on veut se conformer à l’idéal de la science moderne à ses débuts — un mage, enfermé dans sa tour d’argent, enfoui sous ses fioles, ses instruments et ses formules cabalistiques. Il n’est pas non plus un grand- prêtre officiant, ou, ce qui y ressemble beaucoup, un professeur parlant du haut d’une chaire (ce qu’il est devenu …disons, à une certaine époque– pour ne vexer personne).
Le recours aux techniques du dessin fait partie de cette stratégie visant à gagner la conviction d’interlocuteurs raisonnables, lesquels font partie intégrante du monde de cette nouvelle science (caractéristique dont l’évolution ultérieure a gardé trace sous la forme de colloques, conférences et autres séminaires). A cet égard, il n’est pas très étonnant que la science moderne soit née en Italie, en Toscane très précisément : les académies, décrites plus haut à propos du père de Galilée, préfigurent ces lieux de discussion entre professionnels d’une même discipline (Galilée lui-même fera partie d’une célèbre académie, qui s’était doté du nom flamboyant d’Académie des Lynx). Enfin, last but not least, il est remarquable à cet égard que Galilée ait choisi de s’exprimer non pas en latin, langue utilisée par les spécialistes universitaires entre eux, mais en florentin, langue élaborée au sein des académies au siècle précédent sur la base du latin simplifié et des parlers locaux, la langue de Dante et de Boccace ; Dante et Boccace à propos desquels Galilée avait rédigé, du temps de ses études, des essais de critique littéraire.
Galilée s’était livré à des essais de critique littéraire ; telle est la troisième chose que je sais de lui et que je voulais rapporter ici, tant il est devenu inimaginable, en ces temps où règne une opposition « monstrueuse », monstrueuse parce que contre-nature — entre lettres et sciences, qu’un prix Nobel de physique (par exemple) puisse s’exercer à la critique littéraire. Et pourquoi pas ?
La naissance de la botanique en Nouvelle-France
La naissance de la botanique en Nouvelle-France
par Jacques Mathieu
Université Laval
L’auteur du premier livre de plantes du Canada
Le premier livre de plantes du Canada a été publié à Paris en 1635, du temps où Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, vivait encore. L’auteur, Jacques-Philippe Cornuti, est docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, tout comme son père. Il a terminé six années d’études dont une, sous la supervision de Jean Robin, le responsable du Jardin des plantes de l’École de médecine et à la même époque que Vespasien Robin, le fils du précédent, ainsi que d’un apothicaire devenu célèbre en Nouvelle-France, Louis Hébert.
L’intérêt de Cornuti pour la botanique se manifeste relativement tôt. Dès 1623, alors qu’il poursuit encore ses études, il écrit deux petits poèmes en hommage à une publication de son maître en botanique. Devenu médecin en 1626, il s’éloigne temporairement de l’étude des plantes. L’ouverture annoncée d’un jardin royal des herbes médicinales et la perspective d’y faire carrière l’ont sans doute incité à préparer cette publication. Du moins, il ne ménage ni sa peine, ni son argent pour produire une œuvre de qualité.
L’ouvrage porte principalement sur la description de plantes du Nouveau Monde jusque-là inconnues. Il est écrit en latin, seule langue universelle de communication scientifique à l’époque. Il vise ainsi à accroître le répertoire mondial des plantes. La structuration de l’ouvrage, abandonnant l’élémentaire ordre alphabétique, s’inspire des plus récentes avancées dans le système de classification par familles. L’auteur présente l’espèce, puis il décrit la variété canadienne en en faisant ressortir les particularités.
Il donne à son travail une saveur didactique par le recours à de nombreuses illustrations – en général une figure par plante – et dont il produit une représentation distincte et agrandie des fruits, des fleurs et de la racine. Les dessins, malgré une certaine froideur scientifique, sont d’une finesse et d’une précision exceptionnelles compte tenu des procédés d’impression de l’époque.
Non seulement a-t-il été publié, mais l’édition fut d’une remarquable qualité à de multiples points de vue. L’ouvrage se voulait novateur sur le plan du contenu comme de la présentation, dans ses perspectives scientifiques, esthétiques et didactiques. Marie-Victorin considère qu’il marque la naissance de la botanique américaine. Par contre, il est demeuré relativement méconnu, encore de nos jours.
Dans sa démarche, l’auteur combine tradition et innovation. Aux citations des travaux des savants de l’Antiquité, il ajoute le fruit de ses observations conduites sur le terrain. Ses descriptions concernent la forme et la disposition des feuilles, la longueur et le type de tiges et de racines, le nombre et la couleur des fleurs, ainsi que le moment de la floraison. De même, il reprend en partie l’énoncé des vertus médicinales anciennes, mais il n’hésite pas à en expérimenter lui-même les propriétés et usages. Il goûte, hume, dissèque, concocte des potions à partir de la feuille, de la fleur, du fruit ou de la racine.
À la partie principale de l’ouvrage, consacrée aux plantes de la Nouvelle-France, s’ajoutent deux brèves dissertations sur les plantes qui ouvrent la nuit et sur celles qui ouvrent à la chaleur. Ces expériences scientifiques vaudront encore pendant un siècle. Enfin, il publie, sous forme de liste, un premier inventaire systématique des plantes des environs de Paris. Il procède sur la base des lieux d’herborisation qui, de fait, demeureront privilégiés tout au long du siècle suivant.
Le réseau français de Cornuti
Les Robin et Marin Mersenne, religieux et homme de science, ont joué un rôle central dans la carrière botanique de Cornuti. Jean Robin, le père, responsable du jardin de l’École de médecine, lui a enseigné pendant une année l’usage des plantes. Vespasien Robin, le fils du précédent, a suivi la même formation et peut-être en même temps. Ce Vespasien, devenu sous-démonstrateur au Jardin des plantes au moment de sa création en 1635, y a transporté les plantes du Canada, initialement mises en terre dans le jardin de l’École de médecine. Grands collectionneurs, les Robin se préoccupaient d’obtenir des boutures et des racines de toutes les parties du monde. Dans ces jardins, Mersenne agrémentait les promenades en dissertant sur les plantes et leurs vertus. C’est dans ces jardins que Cornuti a pu mener la majorité de ses observations visant à décrire les plantes du Canada.
Devenu médecin en 1626, mais ayant une faible pratique, il offre ses services bénévolement aux religieux minimes où œuvre Marin Mersenne. Ce dernier, l’un des plus grands savants de cette époque, est considéré comme le secrétaire général de la pré-Académie des sciences. Cornuti put ainsi suivre de près les débats sur les thèses scientifiques des personnages les plus célèbres de l’époque, René Descartes, Fabri de Peiresc, Charles de l’Écluse, Ambroise Paré, Galilée, Conrad Gesner, Mathias Lobel, John Tradescant, John Parkinson.
Un deuxième réseau de personnes en relation avec la Nouvelle-France
Cornuti a alors profité de l’existence d’un deuxième réseau de personnes, cette fois en relation avec la Nouvelle-France. La personne qui, dans la colonie d’Amérique, pouvait repérer les plantes du Canada inconnues jusque-là en France devait absolument posséder une connaissance intime des plantes. Seul l’apothicaire Louis Hébert avait une semblable compétence. Le relevé des dates d’entrée des plantes en France, soit entre 1621 et 1627, correspond aux années où Louis Hébert vit à Québec avec sa famille, soit de 1617 à 1627. Au surplus, Louis Hébert a sans doute fait ses études d’apothicaire sous la supervision de Robin père et vraisemblablement durant la même période que le fils Robin. Enfin, un frère de Louis Hébert, Jacques, a vécu chez les Minimes de 1588 à 1632. Il y a d’ailleurs été rejoint en 1632 par Eustache Boullé, le beau-frère de Samuel de Champlain, qui avait également vécu à Québec de 1619 à 1629. Tout un faisceau d’éléments et un réseau complexe de personnes convergent ainsi pour identifier les initiateurs de la publication du premier livre de plantes du Canada.
Ce livre n’a pas connu de succès d’audience. Sa publication en latin, l’absence de traduction avant la deuxième moitié du XXe siècle et le défaut d’identification du personnage de la Nouvelle-France qui en a rendu possible la réalisation expliquent sans doute ce relatif anonymat. Par contre, parmi les plants qui y sont décrits, le Robinier faux acacia (du nom même de Robin) est devenu l’une des espèces d’arbres les plus répandues dans les parcs européens. Le grand Linné a donné au Thalictrum le nom de Cornuti pour signaler son apport à la botanique. Et si l’on n’avait pas fait de Louis Hébert l’Abraham de la colonie parce qu’il est venu avec sa famille ou encore le premier agriculteur à cause de son jardin, on aurait pu, à juste titre, voir en lui le père de la botanique nord-américaine.

Source : Les Presses de l’Université Laval |
Pour en savoir plus : Jacques Mathieu, avec la collaboration d’André Daviault. Le premier livre de plantes de la Nouvelle-France. Les enfants des bois du Canada au jardin du roi à Paris en 1635. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1998, 331p.
Les plantes et les Premières Nations du Québec
Les plantes et les Premières Nations du Québec
par Alain Cuerrier
Ethnobotaniste
Jardin botanique de Montréal,
Institut de recherche en biologie végétale et
Université de Montréal
Les plantes, qu’elles soient alimentaires, médicinales ou encore utilisées dans la confection des habitations, des paniers, des canots, ont permis aux Premières Nations du Québec de trouver les matériaux suffisants pour vivre et s’intégrer à ce vaste territoire qu’est le Nord-Est de l’Amérique du Nord.
Avant l’arrivée des Européens en territoire amérindien, plusieurs nations se partageaient ce qu’il serait mieux convenu d’appeler Turtle Island, soit l’Amérique du Nord. Au sud des Grands Lacs se tenaient les nations iroquoiennes qui, groupées en villages semi-permanents, pratiquaient l’agriculture. Ces nations horticoles laissaient la place plus au nord aux nations de langue algonquienne. Celles-ci, semi-nomades, chassaient, pêchaient et cueillaient les plantes, notamment les petits fruits. Et beaucoup plus au nord, dans l’Arctique, les Inuits occupaient la toundra.

Un lac proche de la communauté crie de Nemaska où vraisemblablement les Cris vont encore cueillir leurs plantes médicinales.Crédit : Alain Cuerrier |
La cueillette comprenait également les plantes médicinales qui entraient dans la guérison de nombreuses maladies. Pour le récollet Leclercq, les Premières Nations étaient à la fois chirurgiens, apothicaires et médecins. Il raconte, à la fin du XVIIe siècle, que les « Sauvages connaissent admirablement bien la vertu et les propriétés » des plantes médicinales. Plus d’un relate cette connaissance que possèdent les Premières Nations du Québec. À la même époque, dans les pays dits civilisés, on pratiquait des chirurgies souvent basées sur une méconnaissance du corps humain, du moins de sa physiologie. N’oublions pas que la circulation du sang est établie par Harvey en 1628… Aussi, il valait mieux se faire opérer par un Inuit, par exemple, que par un médecin du roi! Il se mêlait aux plantes une part importante de spiritualité ou animisme. Chants, jeûnes, et autres rituels de purification (telle la tente à sudation) accompagnaient parfois le traitement fait à partir des plantes.
Mais comment choisir la bonne plante? Il fallait s’en remettre à l’enseignement prodigué par les guérisseurs de la famille ou du clan. Cependant, le rêve révélait parfois au guérisseur la plante à récolter. Par l’observation des animaux, les Premières Nations venaient aussi à découvrir des plantes comestibles ou médicinales. La découverte du sirop d’érable ne serait pas étrangère à l’observation des petits rongeurs, les écureuils notamment, qui léchaient la sève au printemps.
Pour l’équipage de Jacques Cartier, la guérison n’était certes pas du domaine du rêve mais issue d’une réalité combien bénéfique. Le scorbut ravageait son équipage en 1535 lorsque le thé tiré d’un arbre vint à les soulager in extremis. Pour l’ethnobotaniste Jacques Rousseau la plante mentionnée comme annedda par les Iroquois ne peut être que le cèdre blanc (un thuya). Les preuves manquent cependant pour souligner avec certitude tel ou tel arbre. Il s’agit sans aucun doute d’un conifère, mais le cèdre autant que le sapin ou le pin pourrait être cet obscur annedda. Il est même probable que la plupart des conifères possèdent des propriétés antiscorbutiques.
Les travaux d’ethnobotanique indiquent bien que le sapin et les autres conifères figurent parmi les plantes médicinales de première importance! On compte plus de 400 plantes médicinales dans la pharmacopée des Premières Nations du Québec. Non seulement les conifères sont-ils utilisés par l’ensemble des nations mais encore faut-il savoir que, sur le plan des composés actifs et de leurs activités pharmacologiques, ils gagnent de plus en plus en importance. Aussi, ce sont des arbres dont la répartition est vaste et l’abondance au Québec (et au Canada) grande. On continue de nos jours à vérifier les propriétés de ces arbres. On connaît les travaux en cours sur l’if du Canada. Le sapin baumier fait également l’objet de recherche au Québec, notamment comme adjuvant à la chimiothérapie.
Aussi, ne fait-il aucun doute que les Premières Nations n’ont pas attendu que les Européens apportent leurs simples et autres remèdes pour se guérir. La réalité semble tout autre : les Premières Nations ont parfois aidé les Européens à se guérir et lorsque l’on compare l’herboristerie telle que pratiquée par les herboristes du Québec aujourd’hui à la pharmacopée amérindienne, de nombreuses similitudes ressortent qui indiquent clairement un partage de savoirs. Ce savoir persiste heureusement chez plusieurs nations. Il est toutefois menacé tout comme la diversité végétale peut l’être. C’est donc à la fois la culture des Premières Nations (et la culture locale dans son ensemble) ainsi que l’environnement que nous devons protéger. Il convient donc d’outiller les Amérindiens dans un effort de revitalisation de leur culture et de revaloriser l’herboristerie dans son ensemble et, en particulier, ce savoir traditionnel qui hante encore le cœur des Premières Nations.
Michel Sarrazin et les orphelins de la mémoire
Michel Sarrazin et les orphelins de la mémoire
par Jacques Mathieu
Université Laval
Le contexte du 400e anniversaire de la présence francophone permanente en Amérique du Nord et de la fondation de la ville de Québec invite à porter un regard sur la place accordée aux hommes de science qui ont œuvré en Nouvelle-France. S’il est possible de repérer quelques références historiques les concernant, les mémoires collectives semblent au contraire les avoir relégués aux oubliettes. En effet, à l’exception de Michel Sarrazin et ce, pour des raisons assez particulières, bien peu de personnes pourraient nommer des personnages qui, par leur savoir particulier ou par leurs expériences scientifiques, ont contribué au devenir de l’établissement initial.
Histoire et mémoire
L’acte de commémoration évoque principalement des « premières ». Il valorise au premier chef des personnages et des événements. Il accorde une place prépondérante aux gestes associés à des actes fondateurs. Ces « premières » se réfèrent à une époque dite héroïque, ce qui leur confère habituellement une valeur mémorielle spéciale.
Dans le processus de commémoration, histoire et mémoire sont différemment convoquées. L’histoire rappelle et retrace des faits. Elle propose une reconstruction intelligible du passé. La mémoire, elle, évoque plutôt des représentations d’un passé aménagé, souvent embelli et empreint de sensibilités. Sélective, elle joue un rôle mobilisateur qui vise à ancrer les collectivités dans une référence commune et partagée pour concevoir l’avenir.
Dans l’histoire de la Nouvelle-France, les principaux responsables de la colonie naissante, gouverneurs, intendants et évêques, ainsi que ceux qui se sont démarqués par des actions d’éclat comme les explorateurs, les missionnaires et les militaires ont pour ainsi dire été choyés. Modèles de vie, ils ont été jugés dignes de mémoire. On leur a parfois inventé un portrait ou une apparence. Certains ont été statufiés sur la façade de l’Hôtel du Parlement de Québec. D’autres ont reçu l’honneur d’un monument particulier à un endroit stratégique. L’histoire de leur vie occupe une large place dans les manuels d’histoire. Leur nom est devenu un toponyme courant. Des événements ont rappelé par des manifestations publiques le mérite de leurs actions.
Un rappel des expériences de Michel Sarrazin

Portrait de Michel Sarazin huile sur toile, anonyme, France début du XVIIIe sièclePhoto : Idra Labrie |
Cette galerie de portraits et de célébrités n’a fait place qu’à un homme de science de l’époque de la Nouvelle-France, Michel Sarrazin. De façon un peu paradoxale, les noms de Français jamais venus dans la colonie, comme Galilée, Copernic, Descartes ou Ambroise Paré, sont davantage connus. Dans la colonie, seul Michel Sarrazin évoque une telle figure de pionniers, même si d’autres avant lui ont occupé des fonctions similaires. Son nom est célébré surtout comme médecin et savant. L’action d’éclat qui lui a valu reconnaissance et renommée provient principalement de la guérison d’une religieuse en danger de mort que l’amputation du sein cancéreux a permis de vivre encore près de vingt années. Cette expertise médicale lui a valu sa notoriété.
L’expression mémorielle la plus manifeste réside sans doute dans la fondation à Québec il y a une vingtaine d’années de la Maison Michel-Sarrazin vouée à aider les gens à mourir dans la dignité et la sérénité. L’Université de Sherbrooke a créé un prix Michel-Sarrazin qui est décerné annuellement. L’Université du Québec à Trois-Rivières a nommé un pavillon à son nom. Subsiste évidemment le nom de la sarracinea purpurea depuis son identification au XVIIIe siècle. Enfin, en 1999, l’Institut de France en collaboration avec l’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs a tenu à souligner par une conférence publique au Museum national d’histoire naturelle à Paris le tricentenaire de la nomination de Michel Sarrazin comme membre correspondant de l’Académie des sciences de Paris; un honneur mérité, un anniversaire à célébrer.
Cette conférence a fourni une occasion exceptionnelle pour rappeler l’éventail des expériences de Sarrazin, explorer les significations de cette manifestation commémorative et évoquer le relatif oubli des hommes de sciences dans la mémoire collective au Québec.
La nomination de Sarrazin comme membre correspondant de l’Académie des sciences de Paris relève non pas de sa pratique médicale, mais plutôt de sa contribution à la connaissance des plantes de l’Amérique du Nord. Pendant vingt ans, il a envoyé des spécimens de plantes au Jardin royal des plantes (médicinales de Paris). Il a répertorié et décrit plus de 200 plantes, réunissant ainsi la matière d’un manuscrit qui demeura inédit. Outre son travail comme médecin et naturaliste, il s’intéressa à la minéralogie et à l’anatomie d’animaux, procédant à de nombreuses dissections. Il fit une tentative de semer du blé d’hiver, décrivit l’érable à sucre et découvrit une variété de ginseng. Plusieurs de ses travaux furent consignés dans les mémoires de l’Académie et trouvèrent écho dans le Journal des Savants.
D’autres savants oubliés
Sarrazin s’inscrit dans une lignée de savants naturalistes dont les travaux, pourtant reconnus par l’histoire, sont demeurés méconnus du grand public ou de communautés élargies. Parmi ces oubliés, notons en particulier le précurseur de Sarrazin, Jacques-Philippe Cornuti, auteur du premier livre de plantes du Canada, publié à Paris en 1635, le Canadensium Plantarum Historia, ainsi que le rôle qu’a pu y jouer Louis Hébert (Voir autre texte dans ce numéro). Du successeur de Sarrazin, Jean-François Gaultier, aussi membre correspondant de l’Académie, il ne reste que des documents manuscrits et une plante nommée gaultiera. Par ailleurs, ce Gaultier a créé la première station météorologique, tenant de 1742 à 1756 un journal quotidien des variations de température. Son répondant à Paris, Réaumur, a même conçu à son intention un thermomètre spécial pour les basses températures. Enfin Gaultier s’est intéressé à la minéralogie. Ses envois à Guettard ont permis la publication dans le Journal des Savants de la première carte minéralogique du Canada en 1752. Le gouverneur Barrin de la Galissonnière, gouverneur de la Nouvelle-France et naturaliste averti, s’ajoute à cette liste de membres correspondants de l’Académie des sciences. Pour sa part, l’intendant Claude-Thomas Dupuy, qui avait monté un cabinet de physique, s’intéressait à la mécanique expérimentale. Il a conçu une machine hydraulique, une pompe « à élever les eaux » que les enquêteurs de l’Académie ont également approuvée.
La liste pourrait s’allonger considérablement si l’on y ajoutait des personnages qui ont fait montre de leur savoir-faire dans une grande diversité de domaines. L’ingénieur Jean Bourdon a défini l’unité de mesure pour l’arpentage du pays, tiré les premiers alignements de rues et donc en quelque sorte défini le premier plan d’urbanisme de Québec. Chaussegros de Léry a conçu une grande partie du système de fortification et même rédigé un traité des fortifications. Une plaque souvenir a été récemment dévoilée en son honneur à Toulon. Un autre Toulounais, René-Nicolas Levasseur, a assumé la direction des chantiers de construction navale. Jean-Baptiste Franquelin est considéré comme le premier hydrographe du roi. Lui et ses successeurs ont cartographié l’espace colonial et le circuit de navigation du Saint-Laurent. Dès le 30 novembre 1618, un jésuite observe le passage d’une comète. Nombre d’observations astronomiques ont été relevées par la suite. L’on pourrait également faire référence aux travaux anthropologiques de Raudot et de Lafitau sur les Amérindiens. Et la science des Premières Nations, associée à des savoirs traditionnels, a rarement mérité une adéquate reconnaissance. Les vertus de l’anneda, cet arbre de vie qui avait fait des merveilles en guérissant du scorbut l’équipage de Jacques Cartier, ont été si rapidement oubliées que les équipages de Champlain furent à leur tour décimés par la maladie.
Les réalisations scientifiques trouvent difficilement leur place dans la mémoire des nations. De fait, elles semblent oubliées au fur et à mesure que le savoir-faire concerné est dépassé par une connaissance plus avancée ou par une technique plus performante. De plus, si le parcours de ces personnages civils et scientifiques traduit un mode de penser et une dynamique scientifique sans doute francophones, il comporte rarement un caractère national.
L’œuvre des savants accompagne le cheminement d’une société. À ce titre, elle a valeur de patrimoine. Loin d’être figée dans le souvenir, elle est expression vivante et actualisée de l’évolution des savoirs. Elle constitue une valeur en soi, que l’on visite, que l’on habite et qui nous définit. Fondée sur le savoir et le savoir-faire, elle s’inscrit au registre de la science et au service de l’humanité. En somme, du labeur de ces hommes de science, sont nés les projets qui ont posé des jalons mémorables dans l’histoire de l’humanité.
Les lecteurs retrouveront aussi « des objets spécifiques à l’émergence de certaines sciences ayant changé les façons de faire et surtout de penser : astronomie (globe céleste), optique (microscope), magnétisme (boussole). L’avancement de la médecine est illustré par nul autre que Michel Sarrazin (1659-1734), médecin du roi et botaniste en Nouvelle-France, qui mettait en pratique les nouveaux courants médicaux de l’époque.
L’exposition Trésors du temps de la Nouvelle-France – la collection du Musée Stewart, une incursion dans les XVIIe et XVIIIe siècles français, au Musée de la civilisation jusqu’au 19 octobre 2008. »
Michel Sarrazin (1659 – 1734), un vil médecin du roi en Nouvelle-France
Michel Sarrazin (1659 – 1734), un vil médecin du roi
en Nouvelle-France
par Jean-Richard Gauthier
Un parcours hors du commun
Michel Sarrazin est l’un des rares médecins à avoir exercé en Nouvelle-France, seuls trois autres ayant pratiqué leur art dans cette colonie. Sa longue carrière médicale, qui s’étend de 1686 à 1734, est unique : d’abord chirurgien, il sera nommé médecin du roi.1
En plus d’exercer la médecine, il sera botaniste pour le Jardin des Plantes à partir de 1699 et, par la suite, membre de la prestigieuse Académie des Sciences de Paris. Puis, en 1707, il est nommé conseiller au Conseil supérieur de la Nouvelle-France.
Si son parcours est exceptionnel, sa pratique médicale l’est tout autant. Puisque Sarrazin exerce d’abord comme chirurgien, puis comme médecin, sa carrière médicale met en lumière les nouveaux courants médicaux qui donneront naissance à la médecine moderne. En effet, à cette époque, chirurgiens et médecins n’ont ni la même formation, ni la même thérapeutique, ni les mêmes fonctions médicales. Ils se distinguent dans leur apprentissage et leur pratique et sont considérés comme deux professions distinctes.
Un chirurgien remarqué
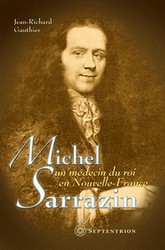
Source: Les Éditions Septentrion |
C’est à titre de chirurgien de navire que Sarrazin s’embarque pour la Nouvelle-France en 1686. Lorsqu’il arrive au Canada, une vingtaine de chirurgiens exercent dans la colonie. Malgré cette présence importante, il se fait remarquer rapidement, car il est nommé la même année chirurgien-major des troupes, par le gouverneur Denonville et l’intendant Champigny. C’est la première fois en Nouvelle-France qu’on accorde ce poste.
Si Sarrazin, en tant que chirurgien-major, doit se consacrer d’abord et avant tout à soigner les militaires, il a également la liberté d’exercer auprès de la population. De plus, il avait toute latitude pour proposer ses soins aux institutions religieuses. À ce titre, les religieuses de l’Hôpital général de Québec retiennent ses services pour répondre à leurs besoins médicaux en 1693. Outre le soin des malades, Sarrazin est parfois appelé à produire des rapports médicaux pour le Conseil supérieur, ce qui témoigne du prestige et de la compétence des chirurgiens- majors.
A l’instar des autres chirurgiens, Sarrazin pratique un métier manuel qui consiste à guérir les maladies externes. Il lui revient donc de saigner, cautériser les plaies, amputer un membre. Le caractère manuel du travail du chirurgien à cette époque apparaît clairement dans le brevet de la métropole :
Aujourd’hui 16 mars 1691 le Roy estant à Versailles voulant commettre une personne capable et expérimentée au fait de la chirurgie pour traiter et panser les soldats des troupes qu’Elle entretient au pays du Canada, et sachant que le Sieur Sarrazin a les qualités nécessaires pour s’en bien acquitter, Sa Majesté l’a retenu et ordonné, retient et ordonne chirurgien des troupes qu’Elle entretient au dit pays […]2.
En 1694, après avoir songé à la vocation religieuse, Michel Sarrazin quitte la Nouvelle-France «pour achever de se perfectionner dans l’étude de la médecine»3. Étant donné l’absence d’institutions d’enseignement dans la colonie, c’est en France qu’il étudiera.
Un vil médecin
Ce n’est qu’après avoir obtenu ses grades à Reims en 1697 qu’il revient dans la colonie. L’essentiel de l’enseignement que reçoit Sarrazin lors de son apprentissage en France demeure axé sur l’étude des écrits anciens, l’enseignement au chevet du malade et la pratique dans les hôpitaux demeurant alors exceptionnels. Ainsi, lorsque Sarrazin s’installe à nouveau dans la colonie, ce n’est plus comme chirurgien, mais comme médecin. À ce moment, seul de ce groupe de soignants en Nouvelle-France, son «bonnet de docteur», selon la hiérarchie, suffit à lui garantir la plus haute place au sein du corps médical de la colonie. Mieux encore, il revient avec le titre de médecin du roi.
Sur le plan pratique, l’application du savoir médical consistait alors pour le médecin à rétablir l’équilibre des humeurs, en conformité avec les doctrines anciennes. Le traitement utilisé était en fonction des symptômes. Pour déceler ceux-ci, le médecin tâtait le pouls du patient, examinait les urines et les selles. Il interrogeait surtout le patient sur ses symptômes. Le patient devenait acteur puisqu’il devait décrire sa maladie. Après, le médecin ordonnait le traitement qui consistait dans la plupart des cas en une saignée, une purgation ou un lavement. Il s’occupe donc surtout de diagnostiquer les maladies et de prescrire les médicaments.
Au début du XVIIIe siècle, le recours régulier à la chirurgie par un médecin est inhabituel. En effet, être chirurgien c’est avoir «vil métier». Le médecin, lui, est un savant qui exerce avec son cerveau. Tout au long du XVIIIe siècle, le médecin touche le moins possible aux malades. D’ailleurs, «Le chirurgien qui briguait les honneurs de la licence en médecine devait s’engager publicis notariorum instrumentis à ne plus faire aucune opération aut aliam artem manuariam4.» Pourtant, plusieurs exemples démontrent qu’une fois médecin, Sarrazin recourt régulièrement à la chirurgie et qu’elle fait partie intégrante de sa thérapeutique : «Le Sr de Sarrazin étant le seul unique médecin qui soit dans tout le pais, […] fait aussy très souvent la profession de chirurgien […]5.»
La forte présence de chirurgiens qui répondent à la majorité des demandes de soins en Nouvelle-France rend encore plus surprenante la pratique médicale de Sarrazin. C’est qu’il fait partie de cette minorité qui décide de rompre avec les anciennes théories et s’appuie sur l’anatomie et l’observation. Initiée par les chirurgiens, dont Jean-Louis Petit (1674-1750), cette nouvelle approche permettra aux chirurgiens de définir les limites d’une intervention thérapeutique et d’expliquer rationnellement la maladie et son évolution.
De même, certains médecins seront aussi intéressés par l’anatomie. De fait, pour eux, la compréhension du corps humain était d’un intérêt certain: «Si utiles qu’eussent été les découvertes anatomiques pour les chirurgiens, elles revêtaient une importance plus grande encore pour les médecins, grâce aux perspectives qu’elles ouvraient à la pathologie»6, c’est-à-dire à la compréhension des causes des symptômes. Pour Richard H.Shryock, «l’intérêt pour l’observation clinique, joint à une exploration plus poussée de l’anatomie pathologique, ouvrait de belles perspectives à la recherche7.»
Influencé par les nouveaux courants médicaux qui privilégient une approche active envers le patient, que ce soit par le biais de ses études en France ou par l’entremise des nombreux livres de chirurgie qu’il possède, Sarrazin n’a jamais renié son expérience de chirurgien et ce d’autant plus qu’elle lui sert dans sa thérapeutique.
1 – Jean-Richard Gauthier, Michel Sarrazin, un médecin du roi en Nouvelle-France. Sillery, Septentrion, 2007, 129 p. [retour au texte]
2 – . Cité Arthur Vallée, Un biologiste canadien Michel Sarrazin (1659-1735(sic). Sa vie, ses travaux et son temps. Québec, Ls-A. Proulx, 1927, p. 18. [retour au texte]
3 – . Lettre de Champigny au ministère, 6 novembre 1695, ANQ-M, AC, Série C11A, vol. 13, fol. 347-366v. [retour au texte]
4 – . Le Maguet, Paul-Émile. Le monde médical parisien sous le grand roi. Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 238. [retour au texte]
5 – . Lettre de Callière et Beauharnois au ministre, 3 novembre 1702, ANQ-M, AC, Série C11A, vol. 20, fol. 56-78. [retour au texte]
6 – . Shryock, Richard H. Histoire de la médecine moderne. Paris, A. Colin, 1958, p. 46. [retour au texte]
7 – Ibid. [retour au texte]
Jean-François Gaultier, médecin du roi botaniste (1742-1756)
Jean-François Gaultier, médecin du roi botaniste (1742-1756)
par Stéphanie Tésio
Docteur en Histoire, Université Laval
Docteur en Histoire, Université de Caen
Michel Sarrazin et Jean-François Gaultier ont des destins assez similaires. Ils sont tous deux médecins du roi au Canada dans la première moitié du XVIIIe siècle, respectivement en 1699 et en 1741. Ils ont pour fonction de soigner les soldats de la colonie et la population de Québec au sein des structures hospitalières (hôtels-Dieu et hôpitaux généraux), et d’agir en cas d’épidémies. D’ailleurs, c’est en soignant l’une d’entre elles, respectivement en 1734 et en 1756 que ces deux praticiens en meurent. Lors de leur mandat, ils agissent tous les deux comme correspondants des académiciens de l’Académie Royale des Sciences de Paris qui les sollisup pour connaître la faune, la flore et les minéraux du Canada. Ils recueillent des spécimens de tout genre, procèdent à des observations et en rendent compte à leurs correspondants de l’Académie. Du reste, deux plantes portent leur nom en leur hommage : la sarracenia purperea pour Michel Sarrazin et la gaultheria pour Jean-François Gaultier.
Dans le courant du XVIIIe siècle, l’accumulation des connaissances et la mise en valeur des sciences se traduisent par la volonté de tout répertorier sur l’ensemble du globe, dans les colonies ou dans les comptoirs commerciaux créés par les métropoles européennes. Jean-François Gaultier de 1742 à 1756 et le marquis de la Galissonnière, gouverneur de la Nouvelle-France, tous deux très versés dans la botanique sont les correspondants de l’académicien Duhamel du Monceau auquel ils envoient des spécimens, malheureusement disparus aujourd’hui.
Trois manuscrits sont attribués à Jean-François Gaultier. Un seul est de façon certaine de sa plume. Il s’agit de la Description de plusieurs plantes du Canada par M. Gaultier, avec les commentaires du marquis de La Galissonnière (1749)1, ayant 175 plantes décrites ; De l’explication des vertus des plantes (1750), sans auteur, et rattaché au fonds de Jean-François Gaultier2 ; d’un manuscrit sans titre et sans auteur, datant du XVIIIe siècle3. Concrètement, le premier manuscrit a 585 pages incluant les pages blanches. Cent soixante-quatorze (174) plantes y sont décrites répertoriées, d’après l’index présent à la fin du document. Les plantes, dénommées en latin, sont classées par ordre alphabétique de A à X, et ne sont pas numérotées. Les envois (numéro et année) ne sont pas précisés. La longueur de la description est variable d’une plante à l’autre, de quelques lignes à quelques dizaines de lignes, soit en fonction des connaissances de l’auteur, soit en fonction des informations recueillies. Le nom générique de la plante est constitué de la grande famille à laquelle elle appartient, puis se subdivise progressivement. Vient ensuite à proprement parler la description de la plante : tige, feuille, fleur, fruit, longueur, largeur, particularités de croissance, quelquefois les usages thérapeutiques.
Ces trois manuscrits, auxquels il faut ajouter celui de Michel Sarrazin, ont en tout 1 203 pages de description de plantes canadiennes. Ainsi, l’histoire botanique canadienne du XVIIIe siècle est un exemple significatif pour mettre en exergue la relation entre l’expansion coloniale et le développement des savoirs scientifiques, entre la France et le Canada.
Jean-François Gaultier recueille les spécimens de deux manières : en se promenant dans la campagne canadienne avec Pehr Kalm en 1749, et en s’appuyant sur le réseau de relations professionnelles du marquis de la Galissonnière, gouverneur, dont les militaires sont postés dans des forts éloignés. Il rencontre beaucoup moins de problèmes que Michel Sarrazin qui doit, à son époque, composer entre autres avec la menace amérindienne.
Trois aspects se dégagent de la mission botanique de Jean-François Gaultier : l’étude des plantes qui peuvent être commercialisées ou cultivées à grande échelle, telles que la capillaire du Canada ; l’étude des plantes comme nouveaux spécimens qui viennent alimenter l’herbier du jardin des plantes de Paris, telles que la sarracenia purperea, la gaultheria et l’herbe à puce ; et l’étude des plantes aux effets thérapeutiques, telles que le sapin blanc et l’épinette rouge.
L’objet de mes prochaines recherches scientifiques portera justement sur ces manuscrits.
1 – B.A.N.Q., C.A.N.Q., P91,D2 (1749).
2 – B.A.N.Q., C.A.N.Q., P1000,S3,D2774 (1750).
3 – B.A.N.Q., C.A.N.Q., P91,D2 (XVIIIe siècle).
Jean-François Gaultier, médecin du roi météorologue (1742-1756)
Jean-François Gaultier, médecin du roi météorologue (1742-1756)
par Stéphanie Tésio
Docteur en Histoire, Université Laval
Docteur en Histoire, Université de Caen
C’est là toute la question de la relation entre climat et maladies.
Bien avant l’émergence des topographies médicales en France, les observations météorologiques de Jean-François Gaultier se situent entre 1742 et 1756. Seules ses observations recueillies entre 1742 et 1748 sont connues. Généralement, les derniers vaisseaux du roi quittent Québec en octobre à cause du froid hivernal qui empêche toute navigation. En conséquence, Jean-François Gaultier rédige ses rapports de telle sorte qu’ils embrassent une année, d’octobre à septembre — excepté pour 1742, première année d’observations, qui commence en novembre. Ainsi parvenu à Paris, chacun de ses rapports ou relevés, appelés « journal d’observations botanico-météorologiques » par Duhamel du Monceau, est lu par cet académicien devant l’Académie Royale des Sciences de Paris.
Jour après jour, mois après mois, Jean-François Gaultier indique les températures en degrés Réaumur dont le système s’approche de celui de Celsius, l’état du ciel (nuageux, ensoleillé, pluvieux, etc.) et l’orientation du vent. Cela permet de connaître le climat de Québec à cette époque, avec des températures saisonnières bien contrastées. Jean-François Gaultier s’attarde à décrire toutes les étapes de la culture des blés, des fruits et des légumes et de la récolte du sirop d’érable; il signale aussi les événements comme les gelées, les inondations et les épidémies de chenilles. Les maladies et les soins ne sont pas son propos central. Il s’inscrit dans un mouvement appelé la « médecine météorologique » ou « médecine aériste », mouvement créé par Hippocrate, remis en vigueur par Sydenham à la fin du XVIIe siècle et largement développé en Europe à partir des années 1770 (http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/decouvreurs/tesio.html).
Jean-François Gaultier effectue ses observations le matin vers 7 ou 8 heures et l’après- midi vers 14 ou 15 heures à un endroit inconnu. Il éprouve des difficultés à plusieurs reprises, particulièrement lorsque les froids hivernaux deviennent intenses. Par exemple, les 20, 21 et 22 décembre 1742, la température est si basse que le liquide du thermomètre se situe dans la boule de l’appareil, en dessous du minimum et ne peut donc pas indiquer une température qui est supposée être inférieure à celle du 19 décembre (-25°). Pour remédier à ces inconvénients, Duhamel du Monceau lui expédie de nouveaux thermomètres dans le courant de l’année 1743, thermomètres à mercure mis au point par Delisle, sur lesquels le médecin réadapte une graduation calquée sur le système de Réaumur.
Les quatre saisons traditionnelles existent au Canada, mais ce sont l’été et l’hiver qui occupent le plus de place dans ses descriptions mensuelles. L’été dure de mai à octobre et l’hiver, de novembre à avril. Les saisons intermédiaires, le printemps et l’automne, durent peu de temps, seulement quelques semaines en mai et en octobre. Sur les sept ans d’observation, en hiver, lors des mois de janvier, février et mars, la température minimale est quasiment identique (c’est-à-dire environ -30°), et ce, en supposant que le thermomètre ait été bien placé et soit fiable. Jean-François Gaultier rapporte d’ailleurs qu’en hiver le fleuve Saint-Laurent gèle et connaît des ponts de glace. Quant aux étés, sauf pour 1743, ils présentent des maximales élevées (plus de 35°). Entre ces deux saisons, les écarts sont donc plutôt conséquents.
Le fleuve Saint-Laurent coulant Sud-Ouest/Nord-Est, il est intéressant de constater que les vents dominants observés sur quatre années pleines (1743, 1744, 1745 et 1748) suivent le cours du fleuve. Leur fréquence étant de la plus haute à la plus basse : vents du Sud-Ouest, du Nord-Est — vent le plus froid selon Pehr Kalm — et du Nord-Ouest.
Sur les 59 mois étudiés, entre 1742 et 1748, Jean-François Gaultier évoque à 13 reprises dans ses relevés l’influence de la météorologie sur les maladies contractées par les Canadiens. La plupart des mentions portent sur des répercussions concrètes du froid ou de la chaleur.
Dans ces 59 mois, tout en sachant que plusieurs de ces maladies apparaissent dans chacun des mois, nous relevons : 51 cas de fièvres ; 13 cas de maladies au niveau de la tête ; 8 cas de maladies au niveau de la gorge ; 43 cas de maladies pulmonaires (pleurésies et péripneumonies) ; 23 maladies au niveau du ventre ; 1 cas de jaunisse ; 2 cas de coqueluche. Sur ces 141 mentions de maladies recensées entre 1742 et 1748, il est clair que les fièvres et les maladies pulmonaires dominent largement et occupent les 2/3 des maladies recensées.
Les fièvres sont présentes toute l’année, même si elles sont effectivement plus nombreuses en hiver qu’en été : en hiver, les 34 mentions se classent ainsi : 13 putrides, 8 malignes, 6 continues, 3 miliaires, 2 éphémères, 1 intermittente ; et les 18 mentions d’été : 6 continues, 4 malignes putrides, 4 malignes, 2 éphémères, 1 ardente, 1 vermineuse. Trois sortes de fièvres règnent toute l’année : les putrides, les malignes et les continues.
Ainsi, il faut retenir de Jean-François Gaultier, médecin du roi en Nouvelle-France, qu’il s’occupe, en plus de ses fonctions officielles, de recueillir nombre de données à caractère scientifique pour les intérêts de l’Académie Royale des Sciences de Paris et de ses membres. Lui et tous ses confères disséminés dans les autres colonies participent activement à cette volonté d’accumuler les connaissances et de les répertorier sur l’ensemble du globe.
La médecine en Nouvelle-France, les chirurgiens de Montréal 1642-1760
La médecine en Nouvelle-France
Les chirurgiens de Montréal 1642-1760
par Marcel J. Rheault
En Nouvelle-France, depuis la fondation de Québec en 1608 jusqu’à la capitulation de Montréal en 1760, soit pendant 152 ans de Régime français, la très grande majorité des soins de santé de la population civile et militaire fut assurée surtout par des chirurgiens. En effet, seulement quatre médecins diplômés d’une université européenne vinrent pratiquer leur profession dans le territoire de la colonie. En sa qualité de siège du gouvernement, de l’amirauté et de l’état-major, c’est à Québec que ces médecins s’installèrent. Aucun médecin ne vint pratiquer la médecine à Montréal pendant cette période.
L’absence de docteur en médecine ne semble pas avoir été préjudiciable à la santé de la population de la colonie. À cette époque de guerre contre les Autochtones et les Britanniques, avec une population relativement jeune, c’était surtout de soins chirurgicaux dont la population avait besoin. À l’exception des épidémies, il fallait davantage traiter les lésions traumatiques accidentelles et les blessures de guerre.
En étudiant la cohorte des chirurgiens qui ont pratiqué dans le gouvernement de Montréal de 1642 à 1760, nous avons voulu connaître le rôle que ces disciples d’Esculape ont joué sur la santé et sur la vie quotidienne de leurs concitoyens. Nous avons voulu connaître s’il y avait une différence dans la qualité des soins offerts à la population de la métropole et à celle de la colonie.
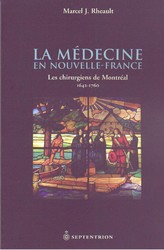
Source: Les Éditions Septentrion |
Notre étude s’est limitée au corps médical dans le gouvernement de Montréal. En nous servant des actes notariés, des actes de baptême, de mariage, de sépulture, en utilisant les archives judiciaires, les décisions du Conseil souverain et la correspondance entre le ministre de la Marine et les gouverneurs de la Nouvelle-France, nous avons relevé les noms de 137 personnes qui ont utilisé le titre de chirurgien dans un ou plusieurs des documents officiels consultés. Nous avons dressé un portrait inédit de ces hommes, qu’ils fussent chirurgiens de bateau, chirurgiens-barbiers, chirurgiens militaires ou qu’ils aient été originaires de France ou de la Nouvelle-France. Nous avons ainsi découvert la réalité de la médecine en Nouvelle-France et il a été possible, jusqu’à un certain degré, de la comparer à la pratique dans la métropole.
Une des premières constatations que nous avons faite, c’est le petit nombre de candidats chirurgiens nés au Canada et qui ont pratiqué dans le gouvernement de Montréal, soit seulement 16 sujets. La majorité des chirurgiens qui ont exercé leur art à la même époque et dans le même gouvernement sont nés en France, soit 121praticiens. Cette situation est facile à comprendre, les autorités de la métropole ne voulaient pas voir se développer une médecine néo-canadienne. On préférait faire venir de France des chirurgiens civils et des chirurgiens militaires dont on était assuré de la compétence. L’un des avantages de cette situation, c’est qu’elle permettait une certaine continuité dans la qualité de la formation des chirurgiens et une certaine uniformité dans la pratique de la médecine et de la chirurgie entre la France et la Nouvelle-France. En effet, la très grande majorité des chirurgiens pratiquant au Canada avaient été formés dans la métropole et, à leur tour, ils avaient formé les chirurgiens canadiens.
Malgré un nombre suffisant de chirurgiens pour pouvoir créer une corporation selon les règles établies pour les provinces françaises, les autorités françaises ont fait très peu d’efforts pour constituer un tel corps de métier en Nouvelle-France. Ce phénomène ne se vérifiait pas uniquement pour la chirurgie, mais aussi pour toutes les autres corporations. La constitution d’une telle corporation aurait pu jouer un rôle important dans le contrôle de la qualité des chirurgiens et aurait pu empêcher la multiplication des charlatans, rebouteurs, sorciers et autres quidams du même acabit qui parcouraient le territoire de la Nouvelle-France.
Les sources primaires trouvées dans les actes officiels ont fourni des renseignements biographiques importants sur ce groupe relativement homogène de chirurgiens qui ont travaillé ou, tout au moins, séjourné à Ville-Marie et dans le gouvernement de Montréal à cette époque. Elles nous ont permis de retrouver leur lieu d’origine, le nom de leurs parents, parfois le métier ou la profession de leur père, leur mariage et leurs descendants. Les actes notariés nous ont renseignés sur leurs activités sociales et économiques dans la cité. Autant de renseignements qui ont constitué la base de la biographie de chacun de ces chirurgiens.
Les sources secondaires utilisées ont été le Dictionnaire biographique du Canada, les dictionnaires généalogiques des familles canadiennes et des familles du Québec et les publications non contemporaines de ceux qui ont colligé des notes biographiques sur les médecins et chirurgiens de la Nouvelle-France. Ces différentes sources nous ont renseignés sur la formation professionnelle, sur la pratique médico-chirurgicale et sur le rôle des chirurgiens dans la société montréalaise.
Nous croyons que ces biographies peuvent être utiles à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la généalogie.
Les livres médicaux au Canada au 18e siècle parmi les praticiens civils
Les livres médicaux au Canada au 18e siècle
parmi les praticiens civils
par Rénald Lessard
Docteur en histoire, Université Laval
Coordonnateur, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec
Stéphanie Tésio
Docteur en histoire, Université de Caen
Docteur en histoire, Université Laval
Les inventaires après décès, actes notariés par excellence, regorgent de détails au sujet des biens de nos ancêtres et nous informent sur leur mode de vie à un moment très précis. Au hasard des lignes, le notaire, témoin oculaire et scripteur, s’attarde, s’il y a lieu, sur la bibliothèque du défunt. De la simple mention à sa description complète, la bibliothèque fournit une idée assez précise des lectures d’alors : la littérature, la religion, l’histoire, le droit et la médecine. Celle-ci devient souvent un outil essentiel pour son propriétaire. Les praticiens de la santé représentent un exemple de ceci. La possession et la diffusion du livre marquent à la fois une meilleure institutionnalisation du savoir médical et une forme d’intellectualisation de la profession. Et qui dit savoir, dit pouvoir.
Nos travaux permettent de recenser pour le Canada français, entre 1608 et 1788, 12 médecins, 20 apothicaires et environ 512 chirurgiens, soit 544 praticiens, nés pour la plupart en France. Sur cet ensemble, seulement 11 fournissent des inventaires après décès avec mention de bibliothèques dont deux d’apothicaires : Claude Boiteux de Saint-Olive (1740) et Jean-Baptiste Chrétien (1800) ; et le médecin Michel Sarrazin (1734). Ainsi, l’étude des inventaires après décès exprime les intérêts professionnels de chacun.
La majorité des praticiens de la santé ont moins de dix livres. Les cas de Bernard Duberger (chirurgien), de Richard Hope (chirurgien) et de Michel Sarrazin (médecin) sont exceptionnels : leurs bibliothèques comptent respectivement 77, 83, et 45 ouvrages relatifs à la pratique médicale. Bernard Duberger a entre autres des livres de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Richard Hope, des ouvrages de médecine et de chirurgie. Michel Sarrazin, des livres de médecine, de pharmacie, de chirurgie, de botanique et de zoologie, ces deux dernières disciplines étant en lien avec ses activités extraprofessionnelles. Au contraire de ce qui est observé parmi les praticiens civils en Basse-Normandie au 18e siècle, les praticiens canadiens ne se concentrent pas sur leur spécialité ; ils manifestent une certaine ouverture intellectuelle due notamment à l’absence de limites professionnelles claires entre médecins, chirurgiens et apothicaires. La pratique médicale se concentre d’ailleurs presque exclusivement entre les mains des chirurgiens. À titre d’exemple, les quelques inventaires après décès d’apothicaires et de médecins bas-normands indiquent nettement pour le 18e que ces personnes possèdent quasiment exclusivement des ouvrages en lien direct avec leur profession, car les champs de la pratique médicale sont très réglementés et bien délimités en France métropolitaine.
Les grands auteurs de l’époque, tels Dionis, Boerhaave, Sydenham, Ettmuller en matière médicale, ou tels Lémery, Bauderon, Charras ou Helvétius en matière pharmaceutique, y sont représentés. Dans bien des cas, les descriptions des bibliothèques dans les inventaires après décès, que ce soit au Canada ou même en Normandie, sont très sommaires, se résumant à l’auteur et au titre quelquefois abrégé. Il manque bien souvent les dates de parution et les éditeurs. Toutefois, les dates de publication et d’inscription au catalogue de la bibliothèque du collège des Jésuites à Québec, une fois rapprochées, montrent que les nouvelles parutions atteignent la Colonie relativement rapidement.
L’achat de livres et leur diffusion ne répondent pas tout à fait aux mêmes critères que la métropole. Il n’y a pas d’imprimerie au Canada sous le Régime français, celle-ci est implantée en 1764 à Québec et en 1776 à Montréal. D’ailleurs, le premier ouvrage imprimé consacré à une question médicale, Direction pour la guérison du Mal de la Baie Saint-Paul, ne paraît qu’en 1785. Généralement, les praticiens canadiens aux 17e et 18e siècles se procurent des livres dans leur pays d’origine et arrivent avec ceux-ci dans la colonie. Une fois arrivés au Canada, soit ils passent commandes auprès de marchands locaux ou métropolitains, soit ils n’hésitent pas à en acquérir lors de vente aux enchères des biens de leurs collègues décédés. Cependant, il est à noter qu’au Canada, ce sont les bibliothèques des communautés religieuses (Jésuites, Augustines entre autres) qui sont les mieux garnies. Or, ces bibliothèques ont subi des pertes majeures à la suite d’incendies et effets de guerre. Il est donc souvent difficile de les reconstituer et de les étudier. Les trois hôtels-Dieu subissent des feux dévastateurs : Montréal en 1695, 1721 et 1734, Québec en 1755 et Trois-Rivières en 1752. Il reste, par exemple, aujourd’hui 135 ouvrages médicaux rattachés au fonds d’archives des Jésuites.
Les caractéristiques générales des bibliothèques médicales d’une grande partie des membres du corps de santé se résument ainsi : livres peu nombreux ; publications en français ; ouvrages généraux plutôt que spécialisés ; ouvrages d’auteurs connus ayant une large diffusion ; livres imprimés surtout à Paris ; rareté des nouveautés ou des livres ayant fait l’objet de polémique ; ouvrages souvent publiés d’abord au 17ème siècle puis réédités par la suite ; ouvrages touchant à la fois à la médecine, à la pharmacie et à la chirurgie ; et enfin, présence d’ouvrages de médecine charitable facilement accessibles.
Au fil des ans, le nombre de membres du corps médical ayant des livres et le nombre de livres par praticiens augmentent. Ils ont à leur disposition les ouvrages les plus courants de leur époque et rien n’indique à ce niveau un retard significatif par rapport à leurs collègues européens.
